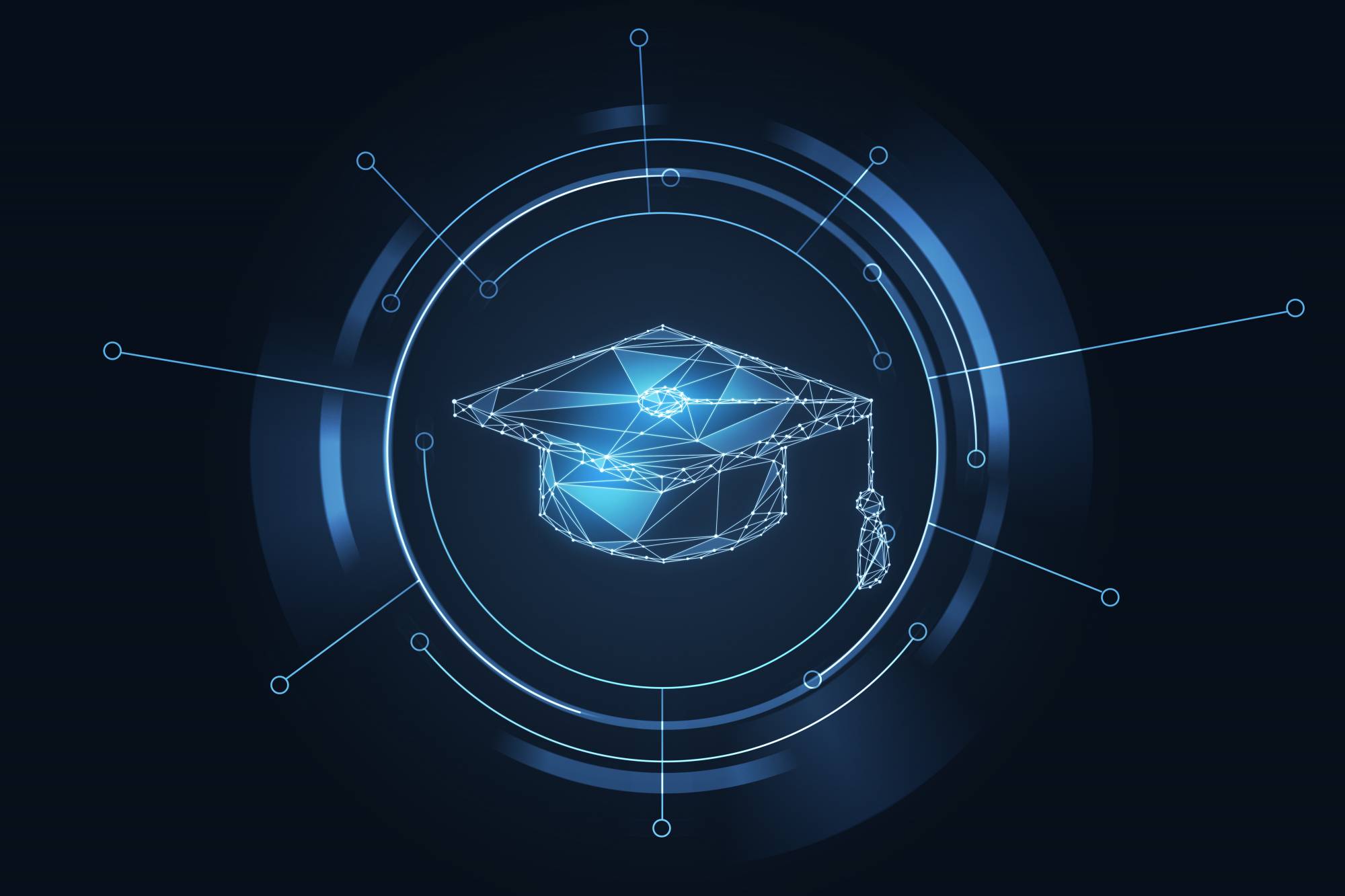Liste des projets lauréats
Thèses :
Titre du projet : Reconnaissance et interprétation de l'environnement pour la navigation autonome sûre et l’action discriminée en milieu agricole
L’exploitation d’outils robotiques pour accompagner la transition agroécologique requiert un niveau d’autonomie élevé, garantissant d’une part la capacité à agir de façon ciblée et discriminée, tout en assurant l’intégrité de fonctionnement. Ces caractéristiques sont fondamentales pour que ces technologies soient efficientes et acceptables par les agriculteurs dans l’accompagnement de leurs nouvelles pratiques. Un tel niveau d’autonomie et de précision impliquent que les robots soient capables d’interpréter l’environnement de façon fiable, afin d’adapter leurs comportements en fonction du contexte et des tâches agronomiques à réaliser, et d’évaluer le risque de franchir les zones à traiter. Si cette notion est bien maîtrisée en robotique d’intérieur, elle est plus délicate en milieux agricoles du fait du caractère évolutif de l’environnement et de l’implantation des parcelles. Aussi, il apparaît nécessaire de développer des outils de cartographie sémantique locale, permettant de discriminer le type d’environnement, son caractère traversable et le type d’opération admissible dans les différentes zones. Cette thèse aura ainsi pour objet le développement d’outils de reconnaissance de l’environnement en exploitant la fusion multi-capteurs. En se basant sur la définition d’une ontologie intégrant contraintes agroécologiques et robotiques, il s’agira de proposer des approches de segmentation et d’apprentissage pour définir des espaces 3D labellisés. Ceux-ci seront exploités pour moduler le comportement du robot à des fins de sécurité (réduction de vitesse, interdiction), ou de traitement spécifique (désherbage différencié, cueillettes, ...), en adaptant des comportements sensori-moteurs. Les résultats de cette thèse permettront de renforcer les capacités d’autonomie et d’efficience des robots pour la réalisation d’opérations discriminées sur les cultures en garantissant la sécurité de déplacement d’engins autonomes dans un environnement évolutif.
Titre du projet : AphiLeg, vers une modélisation multi-modale explicable pour prédire la résistance des légumineuses aux insectes ravageurs
Les légumineuses comme le pois ou la féverole sont des espèces clés pour la transition agroécologique. Néanmoins, alors que les légumineuses bénéficient d'importantes ressources génétiques et génomiques, leur caractérisation fine pour la résistance aux ravageurs reste un défi majeur. Le projet AphiLeg vise à développer des méthodologies innovantes multi-modales explicables pour prédire la résistance des légumineuses aux pucerons, les principaux insectes ravageurs de ces cultures. En combinant vision numérique, génomique et métabolomique, ce projet propose une approche multi-modale pour améliorer la prédiction de la résistance et fournir des explications interprétables des mécanismes sous-jacents. AphiLeg permettra une meilleure compréhension des interactions plantes-insectes en fournissant de nouvelles hypothèses biologiques issues de la modélisation des interactions entre génotype, phénotype et métabolisme. Cette méthodologie sera également un outil décisionnel pertinent utilisable en ""pre-breeding"" et sélection variétale. À long terme, ce projet pourrait avoir un impact significatif sur la gestion durable des cultures et la réduction de l'utilisation de pesticides.
Titre du projet : Modélisation multi-agents des effets combinés de pratiques culturales et des vers de terre sur la structure du sol et proposition d’indicateurs de santé des sols
- Doctorante : Amandine Ouédraogo
- Unité de rattachement : IRD, UMR ABSYS
- Co-encadrement : Cécile Chéron-Bessou (IRD) et Nicolas Marilleau (IRD/UPMC)
- École doctorale : Ecole doctorale GAIA
- Durée du projet : 2025-2028
Cette thèse vise à contribuer à la préservation des sols en développant des indicateurs d’impact des pratiques agricoles sur la santé des sols dans le cadre de l’analyse du cycle de vie (ACV). Actuellement, l’ACV ne prend pas en compte la santé des sols de manière conceptuellement robuste. Pour remédier à cela, la recherche s’appuie sur le cadre de Kibblewhite et al. (2008), qui définit la santé des sols selon quatre fonctions biologiques. L’étude se concentre particulièrement sur le rôle des vers de terre dans le maintien de la structure du sol, ces derniers ayant un impact majeur selon leur mode de vie (anéciques, endogés décompacteurs ou compactants). Toutefois, l’étude expérimentale de ces interactions est coûteuse et parfois irréalisable, ce qui justifie le recours à des modèles théoriques et mécanistes. Les modèles multi-agents, tels que SWORM et CAMMISOL, permettent de simuler les interactions entre vers de terre, structure du sol et pratiques culturales. Ces modèles doivent encore être améliorés et intégrés pour établir un outil robuste capable de traduire les liens entre pratiques agricoles et état des sols.
Titre du projet : Développement et mise en œuvre d'approches d'apprentissage pour l'étude des modifications de l'ARN en lien avec l'adaptation au changement climatique chez Arabidopsis thaliana
L’épitranscriptomique, définie par l’ensemble des modifications des ARNs (> 170 modifications répertoriées), introduit une couche supplémentaire de complexité dans l’étude de la régulation de l’expression des gènes et de leur traduction. De nombreux travaux ont mis en évidence l’importance de ces modifications dans plusieurs processus biologiques essentiels. La technologie ARN direct de chez Nanopore est prometteuse car elle permet théoriquement l’accès à l’ensemble des modifications à l’échelle de l’épitranscriptome complet. Elle a notamment permis de confirmer l’impact majeur des modifications chimiques de l'ARN dans le domaine de la santé. Plusieurs verrous méthodologiques restent rependant à lever pour exploiter au mieux cette technologie. Nous nous proposons de lever certains de ces verrous par le développement de méthodes d’apprentissage profond. Dans le cadre de cette thèse, nous proposons de développer/améliorer les méthodes d'analyse en utilisant des données publiques et générées sur la plante modèle Arabidopsis thaliana afin d ’identifier des signatures épitranscriptomiques associées à la tolérance au stress (thermique et hydrique).
Post-Doctorats :
Titre du projet : Cultures machiniques et transition agroécologique : réseaux sociaux numériques et socialisation professionnelle des élèves en lycée agricole
- Post-doctorante : Laurianne Trably
- Unité de rattachement : Unité INRAE AgroParisTech ECOSYS
- Co-encadrement : Sylvain Brunier (INRAE/AgroParisTech) et Corinne Robert (CERES-ENS)
- Durée du projet : 2025-2027
L’urgence climatique et les impacts environnementaux font de l’agriculture et des modèles d’exploitation agricole un enjeu central de la recherche. Les jeunes générations sont un maillon central de la transition vers des pratiques plus vertueuses, mais leur adhésion aux pratiques agroécologiques transmises en milieu scolaire reste limitée. Ce projet s’intéresse à la manière dont sont reçus et perçus comme légitimes (ou non) les contenus liés à l’agroécologie sur internet, par des jeunes agriculteurs en formation en lycée professionnel. Il cherche à comprendre les effets que peuvent avoir les contenus qui circulent sur les réseaux sociaux sur les pratiques professionnelles des jeunes en formation, et la manière dont ils participent à délimiter l’horizon des pratiques agroécologiques envisageables, au-delà des seuls savoirs transmis par l’école ou la famille. Pour répondre à cette question, un volet d’enquête qualitative (entretiens, observation, littérature grise et spécialisée) ainsi qu’un volet d’enquête quantitative (analyse de commentaires en ligne, questionnaires) seront mis en place auprès de jeunes hommes et femmes dans trois lycées agricoles sur le territoire métropolitain, grâce à une collaboration interdisciplinaire étroite entre sociologie et agronomie.